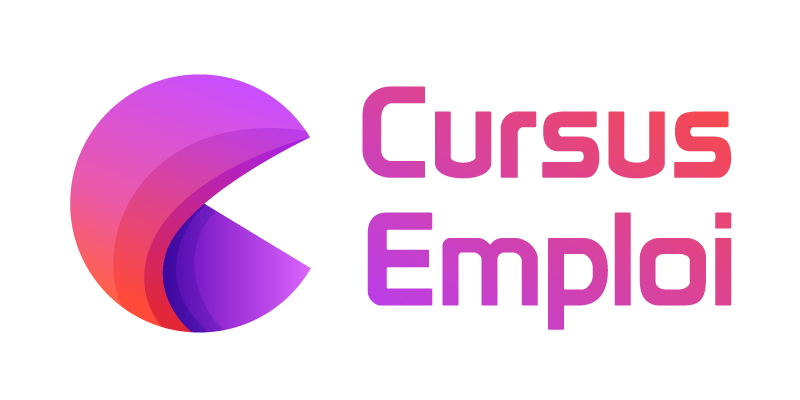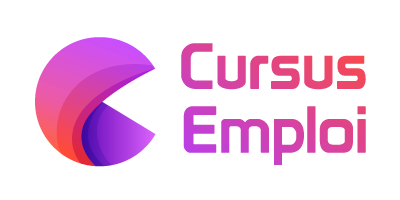En 2025, la gratification minimale d’un stage en entreprise s’établit à 4,35 euros de l’heure, franchissant pour la première fois le seuil des 600 euros mensuels pour un temps plein. Mais seuls les stages de plus de deux mois consécutifs ouvrent droit à cette rémunération, laissant de nombreux étudiants dans une zone grise. Certaines conventions collectives imposent des conditions plus avantageuses que la loi, tandis que les règles d’exonération sociale et fiscale continuent d’évoluer. La moindre modification du statut juridique ou du calcul de la durée du stage peut bouleverser le montant perçu.
Stages en 2025 : panorama des types et cadre légal
Le monde du stage dans l’enseignement supérieur n’a jamais été aussi varié. Entre les durées modulables, les liens étroits avec chaque cursus, l’année d’étude, la période de césure, les objectifs pédagogiques ou les attentes spécifiques des secteurs, aucun parcours ne ressemble à un autre. Les règles, elles, évoluent au gré des filières et des établissements.
Tout commence par la fameuse convention de stage. Trois signatures et elle devient la clef de voûte de l’expérience : celle de l’étudiant, celle de l’établissement et celle de l’entreprise d’accueil. Ce document fixe une durée maximale à six mois par année universitaire, détaille les missions, et rattache chaque tâche au projet de formation. Impossible de contourner la règle : le stagiaire n’est pas un bouche-trou, il ne vient ni remplacer un salarié absent ni occuper un poste vacant. L’entreprise n’a pas le droit de détourner le stage de son objectif formatif.
Pour mieux s’y retrouver, voici les principaux types de stages accessibles en 2025 :
- Stage court : jusqu’à deux mois, aucune obligation pour l’entreprise de verser une gratification.
- Stage long : au-delà de deux mois consécutifs, la gratification minimale (4,35 €/h en 2025) devient obligatoire.
- Période de césure : possibilité de prendre une pause professionnelle, validée par l’établissement, pour gagner en expérience concrète.
Un fil conducteur demeure : tout stage doit s’inscrire dans la logique du cursus et figurer dans le référentiel de formation. L’enseignant référent s’assure de la cohérence du projet, intervient pour garantir le respect du cadre, et valide l’expérience. Obligatoire, optionnel ou en césure, chaque stage obéit à ses propres modalités de convention et de missions.
Quels sont les droits des stagiaires et les obligations des entreprises ?
Depuis 2014, la loi a resserré l’encadrement des droits des stagiaires. L’entreprise doit accorder certains avantages alignés sur ceux des salariés : accès au restaurant d’entreprise, remboursement partiel des frais de transport, parfois tickets restaurant. Côté protection sociale, l’étudiant reste affilié à son régime étudiant ou celui de son établissement. Si un accident survient, c’est l’organisme d’accueil qui prend le relais pour la déclaration.
Une fois la barre des deux mois franchie, la gratification devient automatique. Le montant légal, fixé à 4,35 euros l’heure en 2025, dépend de la présence effective, notée sur la convention. Certaines branches ou grandes entreprises vont plus loin, mais jamais en deçà.
En cas d’inadéquation ou de désaccord, le stagiaire peut interrompre le stage dans le respect des règles prévues. À chaque fin de stage, l’employeur remet une attestation de stage : un document officiel, précieux pour les candidatures futures. Respect des personnes, sécurité, égalité : la loi impose les mêmes exigences pour les stagiaires que pour les salariés, sans dérogation possible.
Au quotidien, ces règles s’appliquent à tous les acteurs :
- Respect strict des horaires et des temps de pause, selon la réglementation en vigueur.
- Interdiction formelle de remplacer un salarié absent ou d’occuper un poste permanent : seules les missions à visée formatrice sont autorisées, sous l’œil d’un tuteur, notamment pour les tâches à risque.
- Pour les stages longs, passage obligatoire par la médecine du travail.
Comprendre le calcul de la gratification, les exonérations et la fiscalité
Le calcul est limpide : dès que le stage dure plus de deux mois, chaque heure de présence donne droit à la gratification minimale de 4,35 euros (2025), indexée sur le plafond horaire de la Sécurité sociale. Ce montant ne varie ni selon l’âge, ni le niveau d’études, ni la spécialité. La convention précise la durée hebdomadaire qui sert de référence.
Seules les heures effectivement réalisées sont prises en compte. Les absences non assimilées, comme un arrêt maladie non prévu, réduisent la base de calcul. Pour tout stage de moins de deux mois, l’employeur décide librement d’une éventuelle rémunération. Au-delà du seuil, la gratification s’impose à tous, sans exception de secteur.
Pour ce qui concerne les cotisations sociales, tant que la gratification reste inférieure ou égale au plancher, aucune charge sociale n’est appliquée, à l’exception de la cotisation accident du travail. Si la gratification dépasse le minimum légal, seul l’excédent est soumis aux cotisations habituelles.
À propos de fiscalité, la gratification de stage n’entre pas dans l’impôt sur le revenu tant qu’elle ne franchit pas le Smic annuel. Au-delà, seule la partie supérieure doit être déclarée. Un point à surveiller lors de la déclaration, histoire d’éviter les mauvaises surprises.
Ressources officielles et conseils pratiques pour réussir son stage rémunéré
Pour se repérer dans cette réglementation mouvante, les sites officiels restent un point d’appui solide : ils détaillent la législation, proposent parfois des simulateurs et expliquent la démarche pour obtenir une convention de stage. Les établissements publient également des guides pratiques pour décortiquer les textes, anticiper les étapes et préparer les entretiens.
Avant de signer, mieux vaut prendre le temps de vérifier chaque clause : missions, objectifs, durée, rémunération, couverture sociale, modalités d’évaluation. L’enseignant référent peut lever les doutes. Échanger avec le tuteur en entreprise reste le meilleur moyen de poser un cadre sain et d’éviter les malentendus.
À l’issue du stage, l’attestation remise par l’employeur viendra étoffer le dossier de candidature. En cas de difficulté, il existe des cellules dédiées dans les établissements et des référents locaux pour accompagner les situations délicates.
Quelques habitudes simples facilitent la gestion de cette expérience :
- Mettez régulièrement à jour vos connaissances sur la réglementation en consultant votre établissement.
- Entretenez un dialogue constant avec vos tuteurs et référents pour anticiper d’éventuels obstacles.
- Conservez précieusement tous les documents relatifs au stage : convention, attestations, évaluations.
L’expérience d’un stage rémunéré ne se résume pas à des textes de loi : tout se joue dans l’engagement quotidien, l’envie de progresser, le respect du cadre et l’ouverture à l’apprentissage. Les textes évoluent, la dynamique personnelle reste la clé. En franchissant cette passerelle entre études et vie professionnelle, chacun dessine peu à peu les contours de son avenir. L’enjeu : transformer une formalité en tremplin.